J'ai fait appel à mon copain ELV de Kourou.
Voici donc le texte in extenso qu'il vient de m'envoyer.
Des migrations successives ont jalonné l’histoire des Guyanes.
Dès le premier millénaire avant Jésus-Christ s’y sont installé des groupes d’Indiens venus de l’Amazonie et de l’Orénoque. Au tournant du XVIe siècle, le mythe de l’Eldorado suscite un déferlement d’aventuriers de tous poils ; les premiers contacts avec les populations autochtones furent sanglants.
Au XVIIe siècle, à travers d’épineux conflits de pouvoir, les expéditions françaises et néerlandaises, puis anglaises, s’enchevêtrent pour profiter du vide laissé par les Espagnols et les Portugais, alors attirés vers des régions moins hostiles. Dans ce contexte aventureux, les Amérindiens sont largement décimés, que ce soit par les armes, ou par le biais de maladies, inconnues d’eux jusque là.
Progressivement, les plantations qui s’installent s’avèrent manquer de bras. Les Amérindiens étant en nombre insuffisant et trop dispersés pour constituer une main-d’œuvre corvéable à merci, la traite des Noirs prend le relais.
C’est donc au XVIIe siècle que l’extension de l’esclavage fut la plus forte, notamment en Guyane Hollandaise, le Surinam, où la mise en valeur des terres, très active, induisait des importations massives d’esclaves. Du XVIe au XVIIe siècle, environ 13 millions d’individus furent ainsi transportés et "traités" dans des conditions dramatiques. D’où venaient-ils ? Non pas d’une région africaine unique, mais de zones parfois fort éloignées, ce qui rendait plus difficiles encore les liens sociaux sur les plantations. Les historiens s’accordent néanmoins à penser que nombre d’esclaves surinamiens auraient eu pour pays natal la Côte d’Ivoire, le Côte de l’Or, la Côte des esclaves et les pays bantous, avec prédominance d’origine dans le Royaume Ashanti.
* "(...) Aux nôtres ils nous ravissent
* tout ça pour nous emporter
* enchaînés sur un navire
* voguant vers la liberté.
* Et lorsqu’ils nous installèrent
* dans leurs cales de malheur,
* je vous dis pas la galère
* la gadoue et la douleur.
* L’air marin creusait nos veines
* nous mettait en appétit
* de sorte que la famine
* gagnait petit à petit.
* Le voyage en d’autres termes
* n’était pas de tout repos
* bien des frères d’épiderme
* devaient y laisser leur peau."
Chanson de BIA, texte Jean Duino - (couplets 2et 3) dans La Mémoire du Vent
Au demeurant, les conditions de vie faites aux esclaves furent d’une telle rigueur, en Guyane Hollandaise surtout, que les insurrections et le "marronage" (fuite en forêt) s’y multiplièrent. Les esclaves les plus vaillants s’enfuirent, gagnèrent la forêt, s’organisèrent en bande, attaquant les plantations si besoin était, pour y faire des émules et se procurer des femmes.
Cruellement poursuivis à l’occasion de véritables "chasses à l’homme", les groupes marrons des forêts surinamiennes menèrent toutefois la vie dure à leurs anciens "propriétaires", créant un climat d’insécurité permanent. De ce fait, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, différents accords de paix furent conclus entre le pouvoir hollandais et les tribus de fugitifs. Le traité signé en 1760 avec les deux tribus dominantes, celles de Saramakas et des DJukas, fut suivi, en 1783, d’un traité conclu avec Aluku Nenge.
À la suite de ces négociations, les esclaves fugitifs purent s’organiser en microsociétés ouvertement reconnues et bénéficiant du libre usage de leurs territoires.
Les ancêtres des Saramakas, des "N'Djukas", des Paramakas et des Bonis qui vivent actuellement en Guyane ont en commun d’être venus d’Afrique entre les années 1650 et 1800, et d’avoir conquis leur liberté dans les forêts surinamiennes.
Ajoutons que dès la première libération des esclaves (février 1794), de nombreux Noirs, plutôt que de continuer à travailler comme salariés dans les "habitations" où ils avaient été esclaves s’installèrent également dans les forêts, phénomène renouvelé en 1802, lors du rétablissement de l’esclavage sous le Consulat. Mais il fallut attendre la Révolution de 1848 pour que l’esclavage fut définitivement aboli.
C’est ainsi, au cours de leur fuite dans les forêts que les Businenge constituèrent leur propre culture, à partir de leurs bases africaines. Cela les amena notamment à développer leur artisanat, non sans un souci d’esthétique certain, qu’il s’agisse du corps, du mobilier, de l’habitat, etc. Cet artisanat leur permis notamment d’instaurer un véritable langage écrit de par la multitude des symboles sculptés et/ou peints dans le bois.
Nota : l’appellation "Noir Marron" vient du terme "marronage", soit la fuite dans la forêt ; le nom "Businenge", qui signifie "l’homme de la forêt", prend donc tout son sens.
2- LES ETHNIES
Compte tenu de leur commune histoire, c’est à l’échelle du Surinam en même temps que de la Guyane qu’il convient de décrire les ethnies qui sont à l’origine de l’art businenge.
Les Saramakas constituent le groupe le plus connu et le plus nombreux. Leur installation ancienne au centre du Surinam, autour de la rivière Saramaka, a récemment subi deux occasions de déstabilisation grave. D’une part, en 1960, la création d’un lac de barrage engloutissant la moitié de leur territoire, a contraint les deux tiers des habitants à un exode forcé. D’autre part, lors de la guerre civile des années 1980, nombre d’entre eux ont fui en Guyane Française, pour un temps plus ou moins long. Certains groupes Saramakas habitent cependant de façon permanente à Kourou, au "Village Saramaka ", Tampac et Saint Laurent du Maroni. La sculpture sur bois reste également vivace dans les deux communautés, française et surinamienne, qui se perçoivent d’ailleurs comme une seule entité.
Les Bonis (ou Aluku), qui se sont formés vers la fin du XVIIIe siècle, ont une histoire largement mythifiée du fait de l’épopée vécue par leurs ancêtres sous la houlette de leur chef historique, Boni, assassiné en 1771 avec son lieutenant Coro Comorentin. Son peuple fut alors vassalisé par les Djukas, de fraîche date alliés des Hollandais. D’abord installés vers le haut Oyapock, les Bonis ont occupé des les années 1860 la rive droite du Maroni, à la suite d’un accord avec les autorités françaises. Il s’agit donc du groupe le plus attaché à la France, implanté surtout dans la région de Maripasoula et d’Apatou.
Une forte tradition de peinture sur bois les caractérise ; excellents navigateurs, ils ont longtemps eu le quasi-monopole de la navigation sur le Maroni.
Les "N'Djukas" (environ 20 000) sont principalement installés au Surinam sur le Tapanahoni. Mais des groupes de plus en plus nombreux vivent également sur la rive française du Maroni dans la région de Grand-Santi-Providence. L’esprit de rébellion et l’ardeur combative des Djukas lors des révoltes anti-esclavagistes sont restés célèbres comme leur aptitude à faire plier le pouvoir hollandais lors de la signature des traités.
Les Paramakas, très peu nombreux en Guyane française, ont installé leurs villages à Langa-Tabiki et Amekan. Ils ont été plutôt cultivateurs que navigateurs. Comme les Kwintis et les Matawais, ils sont issus de la même souche que les Djukas.
Pour survivre des différents groupes ont dû non seulement d’adapter à un environnement difficile, mais inventer leur propre système d’organisation sociale en se fondant sur la mémoire d’origines africaines trop diverses pour qu’un modèle unique pût s’imposer.
L’originalité des institutions mises en place tient sans doute à la nécessité où ils se sont trouvés d’établir une synthèse riche d’ouverture à des modèles très variés, d’abord africains, mais aussi améridiens et européens.
Si des spécificités marquent chaque ethnie, quelques grandes dominantes sont communes. Toutes sont dirigées par un chef coutumier, le Grand Man, garant de la permanence des rites, juge suprême et médiateur dans les conflits. Son pouvoir est reconnu par les autorités de tutelles. Il est assistés par les "Capitaines", organisés en "Conseil" et qui font régner l’ordre dans les villages.
Sur le plan des croyances, c’est une forme d’animisme qui domine, mais revu et corrigé par l’histoire et l’imaginaire de chaque ethnie, qui honore ses propres divinités sur la base d’un dieu suprême appelé Papa Gadu. Le culte rendu aux ancêtres est omniprésent.
Sur le plan linguistique, deux langues sont utilisées : le Saramaka, parlé par les Saramakas et les Matawais ; le Djuka-Tongo ou Aluku-Tongo, vulgairement appelé Taki-Taki, apparenté au Pidgin des côtes africaines, par lé par les Djukas, les Bonis et les Paramakas.
Le banc, de la discorde, en bois serpent pas encore ciré.
Valérie, je m'étonne aussi de ton commentaire sur la fragilité du bois. Les bois guyanais sont très solides, seulement par manque d'hygrométrie, ils craquent systématiquement en métropole. Avec quoi as tu eu ce problème ? je sais que les pagaies sont plus fines donc plus fragiles.
Pour ceux que ça interresse :-) la première plante est du manioc dont nous reparlerons et les plus rase motte sont des cacawettes !!
Je reçois, par mail, le commmentaire très interréssant de Claire, une amie de Saint Laurent, qui étudie le nengee.
Le "taki-taki" ( qui veut littéralement dire "faire du bruit, bavarder" ) est le terme usuel pour désigner la langue des noirs marrons: le "nengee". Je voudrais te préciser qu'il y a plusieurs dialectes nengee: l'aluku tongo, le ndyuka tongo et le pamaka tongo. Le sranan tongo est, lui, utilisé au surinam et n'est pas utilisé dans les villages du maroni.
réf. "Grammaire du nengee. Introduction aux langues aluku, ndyuka et pamaka. Laurence Goury. Bettina Migge. "
C'est le bouquin avec lequel je m'initie au nengee et qui est reconnu comme la référence en la matière.
Pour ceux que ça interresse :-) la première plante est du manioc dont nous reparlerons et les plus rase motte sont des kakawettes !!









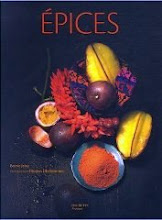


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire